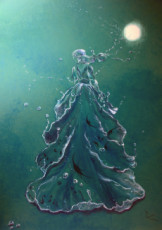Le lait des rêves aurait-il tourné ?

A propos de l’exposition « The Milk of Dreams » à l’Arsenal de Venise jusqu’au 27 novembre.
Il est perplexe, Richard Leydier, le rédacteur en chef du magazine d’art contemporain Art Press. Dans le numéro estival, il se demande carrément en préambule si la Biennale de Venise n’aurait pas décidé de prendre les mêmes pour mieux recommencer. S’il n’y aurait pas un désagréable sentiment de déjà vu sur la lagune. « Anselm Kiefer au palais des Doges après le Grand Palais éphémère ? Anish Kapoor à l’Accademia ? On est reparti pour un tour ? Vraiment ? J’espère que non. » Alors parce qu’il ne veut pas rester terré dans son ressenti tristement désabusé, parce qu’il se dit que, peut-être, « c’est juste l’air du temps qui joue avec les nerfs et déverse son flot vicié dans les canaux de la Sérénissime », le journaliste s’est fait particulièrement attentif à l’ouverture de l’exposition « The Milk of Dreams » organisée par Cecilia Alemani, directrice artistique de la 59e Biennale de Venise. « La sensation qu’on éprouve dès le préambule donne en général le la. » Et ça commence mal. Finalement, ce qui l’énerve le plus, c’est cette impression diffuse qu’on veut le prendre par la main pour lui dire quoi penser.
D’abord, tellement peu d’hommes y sont représentés que Richard Leydier se dit que « tant qu’à faire, autant être cohérent et y aller à fond avec un casting exclusivement féminin ». Ensuite, la sculpture de Simone Leight au centre de la première salle de l’Arsenal ne lui évoque que le qualificatif de « lourde ». Il faut dire que l’artiste de Chicago née en 1968 de parents jamaïcains, qui représente les Etats-Unis dans le pavillon américain, avec au mur des œuvres de la cubaine Belkis Ayon, précède les « grosses sculptures en terre cuite » de Gabriel Chaile, le seul artiste argentin invité à participer à l’exposition centrale. « On ne peut sans doute pas faire plus gros sabots en termes de revendication africaniste », estime Richard Leydier. Pas davantage ému par l’éléphant de la sculptrice allemande Katharina Fritsch.
Provocateur à souhait, Richard Leydier se demande même si tout ceci n’est finalement pas hors la loi, tant est désormais érigé en artistiquement correct le racisme et la discrimination… c’est-à-dire le fait de caractériser les gens en fonction de leurs origines ou de leur sexe, que ce soit négativement ou positivement.
Dans « le grand fatras » que représente pour lui la suite de l’exposition à l’Arsenal, il semble regretter de ne repérer que des figures historiques, comme la peintre et sculptrice Louise Nevelson (1899-1988), ou la très populaire plasticienne Niki de Saint-Phalle (1930-2002). Et des thématiques qu’il pensait « épuisées depuis longtemps », comme le « post-humain », qui remplace simplement l’homme nouveau par la femme nouvelle. Bref, du déjà vu, encore du déjà vu. Mais il a déjà vu tellement de choses, Richard Leydier, depuis le temps qu’il est critique d’art et commissaire d’exposition…
Certes, l’exposition de cette année témoigne d’une « inquiétude quant au devenir de l’humanité » constate-t-il. Mais il pense à celle de 1992, « Post Human », de Jeffrey Deitch, ou à « Corps mutant », une exposition à laquelle participait notamment ORLAN en 2000, à la galerie d’art Enrico Navarra à Paris… et qui en faisaient autant. Tout comme les sculptures de Marguerite Humeau, l’artiste née en 1986 en France et vivant à Londres, à qui le Palais de Tokyo a offert sa première exposition personnelle en 2016, ou celles de l’artiste madrilène Teresa Solar…. « On ne parlera même pas des costumes assez grotesques réalisés durant les années 1920 par la danseuse allemande Lavinia Schulz et son époux Walter Holdt », ajoute encore le critique à la dent dure. Qui finalement aura souvent eu l’occasion de penser au fil de sa déambulation dans l’Arsenal à l’ « eXistenZ » de David Cronenberg. « C’était en 1999 et il semblerait qu’on y soit encore. »
Il faudra encore digérer un fielleux paragraphe sur l’omniprésence des formes vernaculaires lui ayant donné parfois l’impression de ne pas être à la Biennale de Venise mais plutôt à une exposition d’artisanat d’art… pour arriver à la phrase la plus drôle de cet article : « Mais je suis un peu dur, il y a aussi de bonnes choses dans cette exposition. » Ce qui est drôle, bien sûr, c’est le « un peu »…
Et d’énumérer finalement les fameuses « bonnes choses selon Richard Leydier ». L’installation vidéo de Marianna Simnett, grinçante et drôle, trouve grâce à ses yeux. Certaines peintures aussi. Comme celles de Louise Bonnet, « dont l’art est toujours très sexuel » (est-ce un critère de qualité ?). Ou de Felipe Baeza, figurant des êtres hybrides, complétées de collage et de gravure. Celles de Jessie Homer French, aussi, qui assume le côté « regional narrative painter » de ses petits tableaux. Et même s’il sent toujours « quelques relents d’une culture hippie et de bons sentiments dans cette exposition », même si elle « rejoue l’œuvre bien connue de Paul Gauguin dans un style contre-culture sixties », il semblerait que la grande tenture d’Emma Talbot, « Where Do We Come From ? What Are We ? Where Are We Going ? » ne lui déplaise pas trop non plus. Et on imagine que lorsque Richard Leydier trouve « glaçant » le fait que Barbara Kruger « en vient à formellement incarner ce qu’elle entend dénoncer » avec sa grande installation qu’on ne peut pas louper à la sortie de l’Arsenal, c’est un compliment.
Il faudra toutefois aller visiter le pavillon international des Giardini pour voir la séquence la plus réussie de cette Biennale selon Richard Leydier, confrontant les sculptures en verre d’Andra Ursuta et les tableaux minimalistes en laine de Rosemarie Trockel. Quoiqu’il trouve très belle aussi la salle consacrée à Paula Rego, sans pouvoir s’empêcher de reprocher à l’artiste portugaise de jouer un peu à Goya quand même… Heureusement, Hannah Levy est là, avec ses sculptures « étranges et sadiennes », dont les hameçons géants ou les talons aiguilles sur lesquels elles se juchent consolent le journaliste de « la lourdeur ambiante ». A bon entendeur…