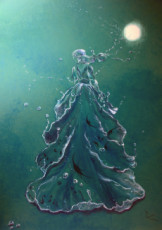Lumineuse et vibrante Sally Gabori

A propos de l’exposition « Mirdidingkingathi Juwarnda Sally Gabori » qui se tient jusqu’au 6 novembre à la Fondation Cartier à Paris.
Elle était tisserande de « dillybags », ces sacs aborigènes traditionnels tissés à partir de fibres végétales et destinés à transporter de la nourriture. Elle vivait de pêche et de cueillette. Elle est devenue peintre à plus de 80 ans, et aujourd’hui son œuvre abstraite s’expose en majesté à la Fondation Cartier, à Paris. Comment Sally Gabori, née vers 1924 sur une île du nord de l’Australie dévastée en 1948 par un cyclone, morte en 2015 sur une autre île du nord de l’Australie où son peuple a été déporté, a-t-elle pu devenir l’une des plus grandes artistes australiennes de ces vingt dernières années, et soudain affoler le marché de l’art contemporain ? C’est que l’exil a élu domicile dans ses tableaux aussi lumineux que spectaculaires. Et que son style n’est comparable à aucun autre dans l’art aborigène.
Certes, on découvre Sally Gabori en France. « La révélation Sally Gabori », titre d’ailleurs Beaux Arts Magazine. On ouvre des yeux ronds à Paris devant ses toiles monumentales éclaboussant tout de leurs couleurs vives. Mais en réalité, elle est une star en Australie depuis longtemps, y étant devenue très vite une véritable coqueluche de l’art contemporain. A peine s’était-elle mise à peindre, en 2005, grâce à l’atelier de peinture d’un centre culturel où elle était passée par hasard, que la galerie d’art moderne Queensland Art Gallery lui consacrait une première exposition en 2006 à Brisbane, et que ses tableaux prenaient place sur les cimaises des musées australiens. L’énergie époustouflante de son geste n’avait pas échappé aux professionnels. Trois ans plus tard, la Cour suprême du Queensland lui commandait une peinture murale, et en 2013 elle exposait au Palazzo Bembo, dans le cadre de la 55e biennale de Venise. Un an après sa mort, en 2016, la Queensland Art Gallery de Brisbane, la galerie d’art qui n’avait cessé de la représenter, organisait sa première rétrospective. Aujourd’hui c’est un panorama signé Sally Gabori qui accueille les voyageurs quand ils débarquent à l’aéroport international de Brisbane. Et ses œuvres d’art à vendre atteignent plusieurs milliers de dollars.
Ce qui est donc vraiment étonnant, c’est plutôt qu’elle soit exposée en France pour la première fois en 2022 ! Et même carrément en Europe : en réunissant une trentaine de ses peintures monumentales, l’institution parisienne qu’est la Fondation Cartier pour l’art contemporain organise en effet jusqu’au 6 novembre la toute première rétrospective européenne de Sally Gabori, cette artiste autodidacte qui fascine autant par son incroyable maîtrise des couleurs et des formes que par son histoire. La sienne bien sûr, celle d’une vieille dame vivant en maison de retraite et qui, à la mort de son mari, se métamorphose soudain en matriarche de l’art contemporain, sans rien laisser transparaître dans son bde toutes les souffrances vécues mais en y insufflant au contraire la joie, la lumière et l’espoir avec une énergie phénoménale. L’histoire de tout un peuple aussi.
Car celle qui est née à Mirdidingki sous le signe du dauphin, comme l’indique son nom complet, Mirdidingkingathi Juwarnda Sally Gabori, a littéralement été contrainte sous des prétextes de catastrophes écologiques de quitter son île natale pour l’île voisine Mornington en 1948, avec tous les autres membres de la communauté Kaiadilt, afin que les missionnaires chrétiens entreprennent… de les « civiliser ». Leur langue comme leur culture et leur cosmogonie se sont ainsi retrouvées promises à la mort. Et les enfants séparés de leurs parents. « Dernier peuple côtier de l’Australie aborigène à entrer en contact avec les colons européens, les Kaiadilt pensaient partir quelques semaines. Il leur faudra attendre quatre décennies pour retrouver le paradis originel, dont cinquante kilomètres à peine les séparaient », écrit Emmanuelle Lequeux dans son passionnant article pour Beaux Arts Magazine.
Ils ne lâcheront rien, les Kaiadilt. Jamais. Leur île, leur terre, c’est Mirdidingki, pas Mornington. Même si les deux îles sont dans le golfe de Carpentarie, dans l’état du Queensland. Et leur exil, c’est l’une des leurs qui en témoignera finalement dans le monde entier avec son pinceau. Jusqu’à avoir les moyens d’affréter un bateau leur permettant de revenir chez eux en famille après un long combat pour voir leurs droits territoriaux et marins reconnus. La culture kaiadilt restera dans l’histoire avec la peinture de Sally Gabori. Et pourtant l’art pictural n’en avait jamais fait partie jusque là. C’est peut-être aussi ce qui a fait de cette mère de huit enfants puis grand-mère aimante et dévouée, l’artiste hors du commun que l’on connaît aujourd’hui.
La première fois qu’elle a eu un pinceau entre les mains, Sally Gabori a pu laisser jaillir tout ce qu’il y avait dans sa propre mémoire, avec la simplicité de la pure sincérité. Elle s’est mise à peindre de façon compulsive, jouant des couleurs primaires de la peinture acrylique pour retourner « au pays » par le souvenir et l’imaginaire. « L’initiation artistique de Sally Gabori s’est faite sans a priori, sans le poids d’une tradition visuelle à suivre », admire Bruce Johnson McLean, directeur adjoint du département First Nations Art de la National Gallery of Australia à Canberra, la capitale du Queensland.
« Ne pouvant s’appuyer sur aucune tradition de peinture coutumière, ni sur aucun héritage de signes et autres symboles qui encoderaient un sens, narreraient les Chemins du Rêve ou dresseraient la carte d’un paysage culturel, Sally Gabori invente son propre style, qui vient saper les idées préconçues des Blancs sur ce à quoi l’art aborigène doit ressembler et ce qu’il doit signifier », s’enthousiasme la conservatrice Judith Ryan, l’une des premières à avoir décelé son talent de peintre. De son déferlement de créativité, Sally Gabori fait naître deux mille tableaux en dix ans, encouragée par les professionnels de l’art contemporain qui l’entourent. Ses toiles sont de plus en plus immenses au fil du temps. Gardienne de son « pays », elle y représente Thundi, le territoire de son père, situé près d’une rivière longeant les dunes, Dibirdibi, le lieu de naissance de son mari à qui la liait une relation dense et intense, ou Nyinyilki, l’un des lieux de son île natale les plus chers à son cœur, plage blanche dans un lagon cerné de bosquets de casuarinas où elle se souvenait avoir pêché un barramundi et récupéré de l’eau douce dans des coquilles de Melo amphora.
« Dans chacun de ces immenses tableaux, qui peuvent paraître purement abstraits, Sally évoque des paysages et des portraits », affirme Juliette Lecorne, commissaire de l’exposition de la Fondation Cartier qui a fait plusieurs fois le voyage jusqu’en Australie pour rencontrer la famille de l’artiste, faire sortir les archives des placards et les restituer aux descendants, traduire les chants dont Sally, qui n’était pas anglophone, aimait accompagner ses toiles, rencontrer ses filles embarquées à leur tour dans l’aventure de la peinture. Toutefois, c’est à une expérience immersive visuelle de contemplation qu’est invité le visiteur de l’exposition parisienne. « Nous ne voulions pas essentialiser ce travail en le présentant sous un œil ethnographique », précise la commissaire. C’est bien l’œuvre d’une artiste contemporaine à la renommée internationale que l’on rencontre donc aujourd’hui.