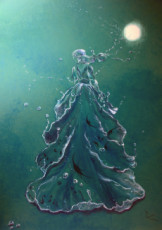L’esprit AfriCOBRA souffle encore à Chicago

A propos de la foire Expo Chicago et du bouillonnement artistique de la ville depuis AfriCOBRA.
Le magazine d’art contemporain Artpress revient ce mois-ci sur la foire Expo Chicago qui a réuni en avril dernier pas moins de 140 galeries d’art venues de 25 pays. Plus exactement, la journaliste et critique d’art Julie Chaizemartin s’en réfère pour prendre « le pouls afro-américain de Chicago ». Car l’événement, qui n’avait pas pu se tenir depuis 2019 pour cause de pandémie, est en 2022 l’occasion idéale pour faire le point sur la scène contemporaine de cette ville ponctuée de gratte-ciel, comptant parmi les plus grandes des Etats-Unis, « réputée pour ses galeries, ses institutions prestigieuses et son œil critique ». Une ville bien connue aussi pour avoir été formidablement marquée par l’esprit d’AfriCOBRA, ce collectif d’artistes afro-américains formé à Chicago en 1968, en parallèle de la promulgation du Civil Rights Act.
On imagine l’émotion des journalistes réunis, à l’instar de Julie Chaizemartin, au bar du très chic hôtel Peninsula de Chicago, lorsqu’ils ont vu arriver main dans la main, « aussi timides que deux enfants attentifs et discrets », le couple mythique formé par Wadsworth Jarell, 93 ans, et Jae Jarell, 87 ans, co-fondateurs d’AfriCOBRA avec à l’époque Jeff Donaldson (1932-2004), Barbara Jones-Hogu (1938-2017), Nelson Stevens (1938-2022) et Gerald Williams (né en 1941). C’est chez eux, dans le South Side, que se réunissaient les artistes Afro-américains en plein combat, nourris d’espoirs de changement, « avec l’idée de construire une esthétique nouvelle dans laquelle ils pourraient graver les difficultés économiques et sociales qu’il reste à surmonter ».
Wadsworth Jarell est de ceux qui, en 1967, avec l’Organization of Black American Culture (OBAC), avaient décidé de recouvrir des visages peints de personnalités inspirantes de la communauté noire, comme Aretha Franklin, Malcolm X ou Muhammad Ali, la façade extérieure d’un magasin du quartier à forte densité afro-américaine de Bronzeville. Le peintre passionné de jazz et de blues choisira de représenter les figures des musiciens Louis Armstrong et Quincy Jones, sur ce qui deviendra le célèbre « Wall of Respect » hélas détruit en 1971 par un incendie. Ce mur est désormais considéré ni plus ni moins comme la première œuvre murale urbaine des Etats-Unis !
« Aujourd’hui, Wadsworth Jarell, costume gris et chapeau sombre, chemise violette rehaussée d’un élégant médaillon, se tient aux côtés de sa femme Jae Jarell, les yeux plus pétillants que ceux d’une jeune fille sous son air réservé », raconte la journaliste d’Artpress. Pour laquelle il n’y a aucun doute : « ils sont toujours fièrement AfriCOBRA. » Car un an après le fameux Wall of Respect, naissait dans leur salon ce mouvement artistique diffusant une palette très colorée, « faite de scansion de lettres et de slogans pour la liberté qui tourbillonnent sur la toile comme un beat de free jazz », écrit Julie Chaizemartin. « Les couleurs que nous utilisions font partie de la philosophie AfriCOBRA, nous les appelons les « couleurs cool-ade », qui se rapportent aux couleurs que les Afro-américains portaient dans les années 1960 dans tout le pays », expliquait Wadsworth Jarell à l’occasion d’une exposition en 2019.
Tandis que Wadsworth faisait donc des tableaux aux couleurs vives de ses portraits kaléidoscopés d’icônes de la communauté artistique noire, en particulier d’Angela Davis, son épouse Jae, influencée par le travail de son grand-père tailleur, confectionnait des robes et des manteaux aux couleurs tout aussi éclatantes, qu’elle vendait dans sa boutique, comme des costumes de révolutionnaires avec des ceintures de balles faites de pastels à l’huile. Difficile de ne pas penser à Robert Delaunay (1885-1941) et Sonia Delaunay (1885-1979), le couple co-fondateur en France de l’Orphisme au début du XXe siècle. La revendication communautaire en moins.
Car bien entendu, l’esprit d’AfriCOBRA est activiste. « Inutile de dire combien nos temps contemporains, secoués par de nouvelles revendications communautaires, dont le mouvement Black Lives Matter est un des étendards les plus puissants, revivifient son héritage alors que les discriminations raciales sont loin d’être abandonnées aux Etats-Unis », fait d’ailleurs remarquer la journaliste d’Artpress qui a rencontré le couple Jarell au milieu d’une exposition organisée avec la galerie d’art Kavi Gupta de Chicago à l’hôtel Peninsula en résonnance à la foire Expo Chicago, et dont le nom reprenait celui d’une toile de 1969 de Gerald Williams : I Am Somebody.
Sur les stands des galeries d’art réunies à l’occasion d’Expo Chicago, la tendance est clairement affirmée selon la journaliste : « une jeune génération s’attèle à nouveau à rendre visible l’identité des corps et des visages des Black People, en écho aux clameurs de la rue, mais surtout pour l’inscrire au sein d’une histoire de l’art ». Et le succès est au rendez-vous si l’on se fie aux prix atteints par les œuvres d’art à vendre du Ghanéen Amoako Boafo, la star trentenaire de la galerie d’art Mariane Ibrahim, dont les coups de pinceaux lumineux font émerger des silhouettes noires habillées avec goût de ses tableaux. Repéré sur Art Basel Miami Beach en 2019, le peintre a vu l’un de ses tableaux faire l’objet d’une enchère à plus d’un million de dollars l’année suivante chez Christie’s.
De la production de cette jeune génération bouillonnante il faut aussi retenir les œuvres de Stan Squirewell, Robert Peterson et Gio Swaby, trois artistes représentés par la galerie d’art new-yorkaise de Harlem Claire Oliver et qui revisitent le genre du portrait pour mieux magnifier les corps africains ou explorer les motifs traditionnels. Les femmes noires d’Elian Almeida prenant la pose des mannequins sur les couvertures de Vogue ont aussi été très remarquées sur le stand de Nara Roesler, galeriste de New York. Mariane Ibrahim, la galeriste du fameux Amoako Boafo, qui a d’ailleurs ouvert en 2021 un espace à Paris, avenue Matignon, présentait également à Chicago les abstractions lyriques de la jeune artiste Carmen Neely.
« Les collectionneurs ici sont très intéressés par la peinture, il y a d’ailleurs peu d’art conceptuel sur les stands », soulignait Jean de Malherbe, de la galerie d’art française La Forest-Divonne, ayant fait le déplacement à Expo Chicago pour la deuxième fois, avec des tableaux à vendre de Jeff Kowatch et de Vincent Bouliès. « Ceci s’explique sans doute en partie parce que l’Art Institute possède une des plus fabuleuses collections de peintures au monde. Ici, l’acte d’achat se décide vite, au coup de cœur. Il ne faut pas oublier que Chicago est la deuxième place financière après New York et la première sur la bourse des matières premières, le cours des céréales est fixé à Chicago. » La preuve qu’effectivement tout est lié dans cette ville de culture formidable aux musées et galeries d’art robustes : le galeriste parisien a vendu à Chicago dix des douze tableaux qu’il avait apportés.