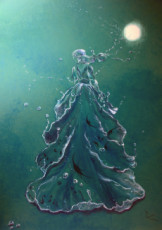Sam Szafran tout en haut des marches

Attention à ne pas trébucher ! Dans les intérieurs de Sam Szafran, mieux vaut regarder où on met les pieds. Dans ses tableaux aussi. Le foisonnement d’objets et de végétation est partout, sans parler des escaliers vertigineux. Mais au musée de l’Orangerie, tout est bien rangé. Presque trop. La sensation de vertige ne viendra donc pas de la scénographie, mais exigera le temps de la contemplation. L’exposition qui s’y tient jusqu’au 16 janvier ne s’intitule décidément pas « Obsessions d’un peintre » pour rien. Des escaliers, des ateliers, des rhododendrons… Et encore des escaliers, des ateliers, des rhododendrons… En soixante-dix peintures environ, le visiteur se voit offrir un aperçu complet de l’œuvre désormais achevé du peintre français disparu en 2019, et qui ne ressemble franchement à aucun autre.
Il le disait lui-même avec beaucoup d’humour noir : « La guerre m’a sauvé. Je me suis ainsi émancipé très jeune. Sinon, j’aurais été tailleur ! » Né Samuel Berger en 1934 à Paris dans une famille de juifs polonais émigrés, l’enfant échappe par miracle à la rafle du Vel d’Hiv et, malgré un passage par le camp de Drancy, réussit à se cacher de famille d’accueil en famille d’accueil un peu partout en France, jusqu’à embarquer en 1947 à Marseille avec sa mère et sa sœur pour l’Australie. Son père et les autres membres de sa famille ont été assassinés à Auschwitz. De retour en France au début des années 1950, la misère et les mauvais traitements font de lui un adolescent des rues, asocial et sauvage, le ventre creux et assailli par des phobies de toutes sortes. Mais définitivement curieux. Il peut exercer tous les métiers le jour, pourvu qu’il puisse aller à des cours de dessin le soir.
Pendant ses années de galère, Sam Szafran vit dans les porches et les bistrots de Saint-Germain-des-Prés ou de Montparnasse pour ne pas mourir de froid, croise l’héroïne… mais survit à tout. Poètes, jazzmen et peintres de la seconde Ecole de Paris deviennent son entourage. Et font son apprentissage. Comme l’écrit Elisabeth Védrenne dans Connaissance des arts, « son amitié la plus forte sera celle nouée avec Alberto Giacometti, dont la rencontre et l’influence lui feront choisir la figuration. Il tisse aussi des liens intimes avec le photographe Henri Cartier-Bresson, rencontre improbable entre un petit juif polack et la quintessence de la grande bourgeoisie française. Les amitiés seront toujours déterminantes. Elles sont sa fenêtre sur le monde. »
Entre 1953 et 1958, Sam Szafran fréquente l’académie de la Grande-Chaumière à Paris, où enseigne le peintre et graveur français d’origine américaine Henri Goetz. Il fait la connaissance des peintres, sculpteurs et graveurs Jacques Delahaye, Jean-Paul Riopelle, Ipousteguy, Orlando Pelayo, Nicolas de Staël, Joan Mitchell, Roseline Granet, Jean Tinguely… Le gamin débrouillard et fouineur va même aider Yves Klein à fabriquer son fameux « bleu Klein » ! Son école aura été la rue, sa force celle de l’autodidacte. « Il ne dépend d’aucune avant-garde, il se sait singulier et s’accepte inclassable », écrit la journaliste de Connaissance des arts. Ainsi Sam Szafran peut-il s’affranchir de tout diktat, et « quitter l’abstraction sans état d’âme pour se tourner vers une représentation figurative alors abhorrée par la majorité des artistes informels ou abstraits qui gravitent autour de lui ».
Il avait réalisé ses premiers collages et œuvres abstraites en découvrant les collages de Kurt Schwitters, les matériologies et texturologies de Jean Dubuffet, Hantaï et Bernard Réquichot… Mais le formidable dessinateur au fusain rongeait son frein, et le pastel va changer sa vie. « Sa patience ne l’empêche pas de maugréer sans cesse ni de se lamenter. Il creuse son sillon, se veut libre comme le vent, au prix d’une misère noire », écrit Elisabeth Védrenne. Car difficile pour Sam Szafran de rentrer sur le marché de l’art et de faire connaître ses œuvres d’art à vendre. De là à faire des concessions picturales, il y a un pas que l’artiste refuse de franchir. On lui a offert une boîte de pastels en 1960, un médium alors complètement passé de mode, et il s’obstine à en tirer quelque chose. Parce qu’il n’aime que se confronter à la difficulté. « Le pastel m’a résisté très longtemps. Ce qui explique que je me suis acharné dessus », expliquait le peintre. On est obsessionnel ou on ne l’est pas.
Ainsi va naître le vocabulaire pictural de Sam Szafran. Dans le retrait de son atelier. A l’écart des débats de son temps. Un vocabulaire de peintre, auquel il aura l’audace encore plus tard de mêler l’aquarelle, sur des toiles de soie chinoise. Imprégnés de ses propres états psychiques, les univers de ses tableaux sont construits comme ceux d’un architecte fou à la Piranèse, « ces espaces où il vit en vase clos et qu’il métamorphose en labyrinthes, en anamorphoses, en vertiges, en jungles… » écrit Elisabeth Védrenne.
Dans le foisonnement de ses représentations d’ateliers où l’on distingue jusqu’à ses bâtons de pastel, apparaît soudain une figure humaine. Minuscule mais rayonnante. Lilette, une jeune femme suisse qui fait de la tapisserie et deviendra diplômée d’Aubusson, a débarqué dans sa vie, « tel un ange », souligne Elisabeth Védrenne. Ils se marient en 1963 et donnent naissance à Sébastien, leur fils, lourdement handicapé. « Le tragique n’est jamais loin », dans la vie de Sam Szafran, comme le constate la journaliste de Connaissance des arts. « Pourtant tout se met en place peu à peu, la vie se fait moins précaire. » Enfin, un marchand d’art repère l’artiste inclassable. Dans sa galerie d’art, Claude Bernard représente désormais Sam Szafran et valorise ses tableaux à vendre.
« Il lui présente Jacques Kerchache, le grand collectionneur d’objets africains, qui lui organise une exposition personnelle en 1965. Il peut enfin travailler dans divers ateliers-refuges qu’on lui prête. De l’atelier de Zao Wou-Ki rue Jonquoy à celui de la rue de Crussol puis au Champ-de-Mars… » peut-on lire dans l’article de Connaissance des arts. Dans les années 1970, Szafran reprend avec quatre amis associés une ancienne fabrique de lithographies rue du Faubourg-Saint-Denis, pour en faire un atelier destiné aux jeunes artistes, où il fera notamment la connaissance d’Arrabal et de Topor. Furent imprimées ici à la fin du XIXe siècle des lithographies des affichistes Steinlen, Chéret et Lautrec, puis des affiches de cinéma. Ce lieu inspire à Szafran l’importante série de vues d’atelier qu’il nomme Imprimerie Bellini, en hommage au peintre vénitien de la Renaissance.
Pour cet artiste singulier, tout tenait du regard. Et forcément du vécu. Car si les escaliers sont aussi présent dans son œuvre, c’est peut-être bien parce qu’enfant, il s’y était un jour retrouvé suspendu dans le vide par un oncle maltraitant. Et s’il ne peint que des espaces clos, c’est peut-être bien parce qu’il sait l’insécurité de l’errance. « Personne avant moi n’avait fait des escaliers, et moi j’ai toujours vécu dans les escaliers. C’est le côté territorial, physique, la survie, les petites bandes de mômes qui tiennent un territoire. » Le môme a survécu 85 ans.