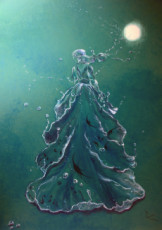Le Street Art s’expose, et pas seulement dans la rue

A propos des nombreuses expositions consacrées cet été au Street Art partout en France.
« Quand on dit que l’art urbain doit rester dans la rue, ça me rappelle quand on était jeune et qu’on nous disait « le rap, ce n’est pas de la musique ». On a l’impression que se rejoue la querelle des classiques et des modernes. » Dixit Sowat, l’artiste franco-américain ayant couvert de graffitis les voies ferrées de Marseille. Je trouve ça tellement bien vu…
L’art de la rue peut-il entrer au musée ? Les œuvres d’art exposées dans l’espace urbain peuvent-elles devenir des œuvres d’art à vendre dans les galeries d’art contemporain ? Bref, le Street Art est-il en droit affoler le marché de l’art ? Doit-on écrire « artiste plasticien issu de l’art urbain » pour désigner un street artiste qui vend ses œuvres d’art à des acheteurs les accrochant dans leur salon ? C’est la question que se pose cet été le magazine Connaissance des arts, face à la multitude d’expositions proposées actuellement sur le sujet. « La question de savoir si l’on peut exposer le graffiti hors de la rue est un marronnier dans le milieu de l’art », notent très justement Lek & Sowat, le célèbre duo d’art contemporain français auquel une rétrospective est consacrée jusqu’au 27 juillet au Domaine départemental Pierresvives à Montpellier. « Pourtant l’art urbain ne se crée pas seulement dans la rue et suppose tout un travail de préparation, d’esquisses, mais également de captation photo ou vidéo », ajoutent-t-ils. C’est justement sous cet angle, celui de l’approche documentaire, que le musée des Beaux-Arts de Rennes a choisi de construire l’exposition « Aérosol, une histoire du graffiti », à voir jusqu’au 22 septembre pour plonger dans l’univers du graffiti, des années 1960 à nos jours, à travers le prisme de l’usage de la bombe aérosol à des fins artistiques.
« Il est difficile de parler de la rue sans la montrer », explique Patrice Poch, artiste et co-commissaire de l’exposition avec Claire Lignereux et Nicolas Gzeley. « On a fait le choix de présenter le moins possible d’œuvres d’atelier. Il y en a une vingtaine en tout, ce qui est très inhabituel dans un musée des beaux-arts. »
Qu’il s’agisse de bombage à main levée, de pochoir ou de graffiti-writing, l’aérosol s’impose comme une forme d’expression artistique plurielle, riche de plus d’un demi siècle de pratique. Tantôt illégale, tantôt tolérée, la création peut se développer sur des palissades, des rames de métro ou en atelier. Né dans la rue, c’est un art par nature éphémère : lui consacrer une exposition dans un musée est un défi. Ce projet part du constat que la pratique du graffiti est à la fois très populaire et néanmoins largement méconnue : dans la première partie de l’exposition, les visiteurs peuvent donc retracer précisément l’émergence du graffiti en France, des années 1960 à 1986, avec des œuvres d’art rares et inédites (Blek le rat, Jef Aérosol, Marie Rouffet, Miss.Tic, Bando, Futura2000, Blitz, Dee Nasty, Loly Pop…) ainsi que de nombreux documents, photographies et témoignages.
Afin de prolonger cette approche historique et témoigner de la vitalité exponentielle du graffiti à partir de la fin des années 1980, l’espace du patio du musée propose quant à lui un focus sur le thème du train et du métro, support privilégié des writers, à partir des collections du Mucem, premier musée européen à avoir constitué un fonds dédié à ce mouvement au tout début des années 2000. L’exposition dans le patio présente œuvres d’art, objets et photographies retraçant l’activité des « trainistes » européens. Ces artistes ayant finalement apprivoisé un outil, la bombe aérosol, qui était au départ conçu pour peindre des carrosseries…
« Qui dit marché de l’art urbain dit Banksy », note la journaliste de Connaissance des arts. Pourtant, « comme un arbre cachant la forêt, la « Banksymania » masque un marché beaucoup plus contrasté, avec par exemple des plaques d’aluminium de Jef Aérosol à partir de 3 500 €. Après une grosse décennie d’emballement, la cote de l’art urbain se resserre autour de valeurs « sûres », comme Invader, Shepard Fairey et plus récemment Gérard Zlotykamien. »
Il n’en demeure pas moins que « l’art urbain s’invite même au Petit Palais, où Mehdi Ben Cheikh, fondateur de la galerie Itinerrance, s’associe à la journaliste Annick Cojean pour réunir la plupart des artistes qui ont fait le succès de son parcours Street Art dans le 13e arrondissement de Paris. Pas mal, pour un phénomène artistique plébiscité par le public mais longtemps boudé par les institutions… » relève Camille Deschamps dans son article pour Connaissance des arts. Eh oui, l’art urbain est plébiscité par le public. Son côté immédiatement accessible sans doute. Je ne sais pas vous, mais moi personnellement je suis bombardée toute l’année de photos d’art urbain prises par mes amis à l’occasion de leurs pérégrinations, assorties du petit commentaire rituel : « Tu vois, nous on ne va pas dans tous les musées mais on voit aussi plein d’œuvres d’art – smiley clin d’œil ».
Ayant régulièrement l’occasion de poser ma roulotte à Nancy, j’en ai bien entendu profité pour découvrir l’œuvre d’Aletaïa, artiste plasticienne issue du Street Art. Elle avait été invitée grâce à la directrice du musée des beaux-arts nancéien à participer à la table ronde intitulée « De l’art urbain pour fabriquer les villes », lors de l’édition des Rencontres Urbaines de Nancy 2022. Découvrant alors cette ville, et poussée par sa curiosité, elle s’est laissé embarquer dans un projet d’exposition : Egotarium. « Avant que Susana Gallego Cuesta ne m’invite à Nancy, je ne cherchais pas à exposer mon travail dans les galeries et les institutions », confie l’artiste à la journaliste de Connaissance des arts. « Je n’étais pas friande de ça, j’étais dans un désir d’extérieur, de monumentalité. Je trouvais que mon travail avait un sens dans la rue, mais ne fonctionnait plus en atelier. Mais que fait-on quand on a 45 ans et qu’on ne veut plus être à genoux par terre dans la rue ? »
Avec Egotarium au musée des beaux-arts de Nancy, Aleteïa se lance donc à l’assaut de la forme muséale et tente une catastérisation générale de son rapport au monde. Ce qui m’a permis de découvrir au passage le mot « catastérisation », et ça, j’adore : « transformation d’un être en constellation ou en étoile, ou transfert de son âme dans le ciel ». Bref, il est question ici d’ego artistique, traité avec distance et ironie, mais surtout de sa difficile construction quand on est une femme : comment, contre vents et marées, en plein patriarcat, devient-on Aleteïa ? Etant entendu que l’exposition questionne également par la même occasion l’ego de l’humain du 21e siècle, son rapport à la nature et à son histoire contemporaine. Autant dire qu’il y a de quoi faire.
 Article écrit par Valibri en Roulotte
Article écrit par Valibri en Roulotte
Illustration : © Nicolas Gzeley