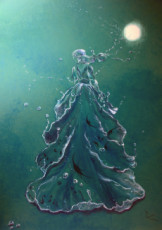Marché de l’art contemporain ou art marchand ?

A propos de l’exposition « BeauBadUgly – L’autre histoire de la peinture », visible jusqu’au 9 mars 2025 au MIAM (Musée international des arts modestes), à Sète.
« Le flirt avec une esthétique kitsch, populaire et même vulgaire, a tenté des représentants de presque tous les mouvements de l’art moderne et de toutes les tendances de l’art contemporain. » Ce n’est pas moi qui le dis, mais Catherine Millet elle-même, qui l’écrit dans le numéro estival de la revue Artpress dont elle dirige la rédaction. A l’occasion de l’exposition « BeauBadUgly – L’autre histoire de la peinture », visible jusqu’au 9 mars 2025 au Musée international des arts modestes, à Sète (alias le MIAM d’Hervé Di Rosa), le prestigieux magazine de référence de l’art contemporain consacre en effet un passionnant dossier à la question qui titille : selon quels critères juge-t-on les œuvres d’art comme étant des œuvres commerciales et de mauvais goût… plutôt que des œuvres d’art contemporain ? Quand je vous dis que c’est passionnant ! Au vu de l’amplitude du sujet, la célèbre critique d’art ne s’y colle tout de même pas toute seule. Quatre autres « experts » ont été missionnés pour donner leur avis sur la fameuse question. Je vous parlerai donc peut-être un autre jour des points de vue de Paul Ardenne, Annabelle Gugnon, Romain Mathieu et Thomas Schlesser, mais, à tout seigneur tout honneur, je vais commencer par la cheffe.
D’abord une petite mise en contexte. L’exposition se présente en deux parties : dans la partie « historique », on retrouve les « stars » de la peinture dite marchande, comme Vladimir Tretchikoff (mais si, vous savez, ce portrait de femme chinoise hyper coloré qui apparaît aussi bien dans un clip de David Bowie que dans un film d’Alfred Hitchcock, et qui a fait de ce Russe autodidacte très controversé l’un des peintres les plus riches du monde), mais aussi Bernard Buffet (si si, ses clowns étant devenus trop vite trop populaires, il joue dans cette catégorie), ou Félix Labisse et ses femmes bleues, bref, tous ceux dont les œuvres d’art à vendre se sont justement « trop bien vendues pour être honnêtes ».
Ce panorama de la peinture commerciale, médiatique et populaire, est mis en scène par Hervé Di Rosa et Jean-Baptiste Carobolante, l’auteur d’une étude qui a servi de point de départ à cette exposition, et s’attarde sur les différentes trajectoires qu’a pris ce champ pictural au XXe siècle : de l’idéalisation du corps féminin au paysage touristique, en passant par la médiatisation des peintres et la naissance d’un nouveau public artistique populaire. À chaque fois, les peintures présentées sont autant une réminiscence pour le public qu’une découverte radicale.
Dans la seconde partie, que l’on peut qualifier de « contemporaine », on retrouve par exemple John Currin, Richard Fauguet, Gérard Gasiorowski, Pierre et Gilles, Ida Tursic & Wilfried Mille, et Nina Childress qui est d’ailleurs la co-commissaire de cette partie avec Colette Barbier, longtemps directrice de la fondation Pernod Ricard. Ce qui m’amuse, c’est que d’après Catherine Millet, ce sont ces derniers noms qui devraient nous être plus familiers que les autres… Soit. En tout cas, cette sélection d’œuvres contemporaines permet de montrer l’importance de la « peinture marchande » dans l’imaginaire artistique contemporain. Et donne à voir à quel point le monde marchand est devenu un champ de référence iconographique incontournable pour comprendre les racines de la création contemporaine.
Alors pour s’y retrouver, si vous avez parfois des doutes, c’est simple : la partie historique est au rez-de-chaussée du MIAM, la partie contemporaine à l’étage. Et les trois-cents « croûtes » peintes au couteau, du très conceptuel Gabriele Di Matteo, toutes pareilles mais toutes différentes, font le lien entre les deux, entre l’histoire et le présent. Tout particulièrement, l’exposition présente de nombreuses variations autour de l’héritage de la fameuse figure parisienne du « Petit Poulbot ».
Mais revenons-en à l’analyse de Catherine Millet pour Artpress, qui estime que BeauBadUgly est non seulement l’un des projets les plus audacieux du MIAM, mais qu’il est même plus pertinent que High and Low, la grande exposition s’étant tenue au MoMa, à New York, pendant l’hiver 1990-91, dressant un vaste panorama de la modernité ayant emprunté aux arts populaires. Rien que ça ! « Certes, le MIAM n’a pas les moyens du MoMa », reconnaît-elle tout de même, « mais son projet, impertinent, est aussi plus pertinent : confronter des œuvres d’art contemporain qui usent de formes et de thèmes propres à l’imagerie populaire à celles d’artistes qui ont réalisé des œuvres très populaires, mais sans s’inscrire dans le champ de l’art contemporain. C’est-à-dire confronter des œuvres originales à d’autres œuvres originales qui souvent se ressemblent, mais qui ne sont pas diffusées au sein du même marché, le marché-de-l’art-contemporain pour les uns, la place du Tertre ou les grands magasins pour les autres. » Eh oui : vendre ses œuvres d’art en galerie d’art ou en supermarché, toute la différence est là. Il faut choisir (si on peut).
La lectrice que je suis ne peut évidemment pas s’empêcher de penser que ça fonctionne exactement pareil en littérature ! Si vous lisez du Marc Lévy, du Agnès Ledig ou du Guillaume Musso, je vous préviens, vous ne jouerez jamais dans la même cour que ceux qui lisent d’illustres inconnus et qui vous regarderont toujours de haut. Idem si c’est vous l’écrivain ou l’écrivaine. Vous ne voudrez pas manger de ce pain-là. N’empêche que si vous voulez manger en publiant des romans, vous rêverez d’en vendre autant que les auteurs populaires que je viens de citer (il y en a d’autres). Parce que c’est un peu ça le problème au fond : comment vivre (bien) de son art s’il n’est pas marchand ? Catherine Millet avance même que les « artistes contemporains » ne sont pas toujours au-dessus des considérations mercantiles attribuées aux « artistes marchands »… Dans son propre Musée du Mauvais Goût, la critique d’art n’hésite pas à accrocher les Nus de Francis Picabia, les Dick Tracy, Superman et Popeye d’Andy Warhol, les comics de Peter Arno revisités par David Salle, les all over floraux de Robert Zakanitch, les Chats et les Papas d’Alain Séchas, les zips de Barnett Newman transformés par Philip Taaffe, et même les cyclopes d’Hervé Di Rosa lui-même…
« En sens inverse, l’évolution générale du goût induite par l’art moderne a exercé une influence sur la peinture-marchande », estime-t-elle. « En témoigne la liberté chromatique et de facture que s’autorisent André Brasilier et Vladimir Tretchikoff. Les ailes du cygne formant la voûte céleste de Wings of Love (1972), de Stephen Pearson, est une dégénérescence sentimentale de l’espace onirique et des images doubles de Salvador Dali. Toutefois, il y a un seuil de laideur ou un type de laideur dans lequel la peinture-marchande ne se risque pas : si elle admet les yeux monstrueux peints par Margaret Keane, je doute que les yeux louches de Stéphane Zaech ou ceux « barbouillés » de Nina Childress y rencontrent le succès. Il y a une limite à l’art marchand, c’est l’ironie. » J’adore. Comme j’adore la nouvelle question avec laquelle Catherine Millet répond finalement à la première : « Qu’est-ce qui se passerait dans la tête du/des publics si le parti-pris d’accrochage avait mélangé toutes les œuvres ? » Je pense qu’on aurait des surprises.
 Article écrit par Valibri en Roulotte
Article écrit par Valibri en Roulotte