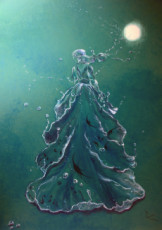Décodé pour vous dans ART PRESS

Fini d'abuser la galerie
À propos de l'exposition Histoire(s) sans fin au Réverbère à Lyon jusqu'au 28 décembre
Une galerie d'art qui ferme, c'est toujours désolant. C'est encore plus rageant si ce temple de l'art vivant baisse le rideau après avoir animé pendant plus de quatre décennies la vie culturelle et artistique de sa ville et sa région comme le fit avec un retentissement national le Réverbère à Lyon. Fondée en 1981 par le photographe Jacques Damez et sa compagne Catherine Derioz, cette galerie ambitieuse aura tenu jusqu'au bout le positionnement exigeant de se vouer exclusivement à la photographie contemporaine dans tous ses états. C'est ainsi que ses cimaises ont accueilli dans un écrin amoureusement valorisant des œuvres de Marc Riboud, Bernard Piossu, William Klein ou Denis Roche côté grands classiques aussi bien que des travaux moins reconnus de Beatrix von Conta ou François Deladerrière. Les raisons de la fermeture du mythique Réverbère sont tristement faciles à deviner. La galerie aura survécu à la crise du Covid. Mais elle n'a pas été en mesure de faire face à l'explosion des coûts de l'énergie et de production. Elle n'a bénéficié d'aucun soutien des instances municipales comme si Lyon ne se souvenait pas d'avoir été la ville des frères Lumière. Le naufrage du Réverbère est aussi emblématique du combat de l'art contemporain en général. Sur un marché animé par une nouvelle génération de collectionneurs attirés selon Catherine Dérioz par « le buzz, le décoratif et le spéculatif » une approche poétique soucieuse d'offrir des expositions dotées d'une réelle cohérence artistique semble relever d'un autre âge. En préférant les collectionneurs désargentés aux financeurs qui l'auraient entraînée vers le sensationnalisme bankable, la galerie s'est en quelque sorte sabordée pour rester libre et indépendante. C'est cet esprit d'indépendance qui a poussé le Réverbère à conclure son épopée en apothéose avec une toute dernière exposition intitulée Histoire(s) sans fin en forme de retrospective et de bouquet final. En attendant d'autres aventures hors les murs. Comme quoi l'art contemporain n'en finit pas de mourir. C'est sa façon de vivre.
Illustrations : Autoportrait de Jacques Damez (1959)

Arte povera : le théâtre des objets
À propos de l'exposition arte povera à La Bourse de commerce de Paris jusqu'au 20 janvier 2025
Montrer que l'arte povera ne se résume pas à un mouvement circonscrit à une époque telle est l'ambition affichée par l'exposition à laquelle la Bourse de commerce consacre actuellement la totalité de ses espaces. Car l'arte povera est, comme le formule élégamment Art Press, « une poétique qui emprunte au théâtre d'avant-garde un nouveau rapport à l'espace et aux choses ». Et non comme une simple réaction à l'industrialisation et l'américanisation de la société italienne. C'est sur la base de ce parti pris qu'ont été choisies une cinquantaine d'œuvres de la galerie Pinault ainsi que deux cents cinquante autres empruntées à diverses collections européennes. Les mouvements d'avant-garde ayant quasiment tous rayonné pendant une très brève période de quelques années, montrer en quoi ces inventeurs d'avenir sont encore présents est un challenge ambitieux. Une plongée dans la genèse du mouvement s'impose pour en cerner l'esprit. Boetti, Koinellis et Pascali, piliers de l'exposition inaugurale de 1967 ont posé qu'une sortie du système, un détachement des conventions traditionnelles, était possible par le bas à travers l'affirmation de la simplicité de la matérialité brute. C'est en sondant toutes les dimensions de l'espace que peut être débordé le cadre de la représentation. L'espace n'est cependant pas abstrait ici. Il est scène à vivre, histoire, habitation. Comme les igloos de Mario Merz. Comme les objets qui qualifient et définissent les lieux qu'ils peuplent. C'est dans cet esprit que Pistoletto capte en miroir l'image des spectateurs dans son œuvre même pour la mêler à des silhouettes grandeur nature. Il ira plus loin avec Oggetti in meno dont les « objets en moins » amorcent chacun une piste distincte pour finalement la laisser en plan, faisant précisément de cet inachèvement hétérogène le sens de leur exposition. Par l'interrogation qu'il suscite des relations de l'Homme aux objets dans l'espace devant témoins, le théâtre est source d'inspiration pour l'arte povera. Cela commence naturellement avec le « théâtre pauvre » théorisé par Jerzy Grotowski. Mais, à l'image du Living Theater, c'est dans un art dramatique rejetant la distance entre acteurs et spectateur que peut se saisir l'âme de l'arte povera : le théâtre de lo Zoo, compagnie fondée par Pistoletto et Colnaghi. Ce sont les chiffons et oripeaux du Zoo qui deviendront les symboles visuels de l'art pauvre. À la suite de Quartucci, le théâtre se fait cœur du concept d'exposition comme nouvelle scène de représentation. Le tout dans une forme brute sans mise en scène apparente. La figure emblématique de l'exposition comme scène est Paolini qui s'illustrera notamment avec les toiles blanches présentées en recto et verso de Senza titolo ainsi que par ses collaborations avec Quartucci. C'est dans ce rapprochement de l'art pictural avec le théâtre, cette « communion existentielle » selon les mots d'Anselmo que se façonne l'arte povera. Dans les galeries qui le promeuvent, les œuvres sont tout sauf des objets isolés livrés à la contemplation de spectateurs détachés dans des lieux pensés comme des prolongements naturels de ces objets. L'étiquette d'arte povera fut déclarée obsolète par les figures de proue mêmes du mouvement en 1970. De Celant à Amman qui ouvrit le débat vers des « processus de pensée visualisés ». La matière n'étant plus qu'un « véhicule d'expression ». L'arte povera aura ainsi été une forme morale de théâtre de l'objet dont son contemporain, le pop art, aura fait le symbole plastique et «riche » du consumérisme. L'arte povera, lui, n'a pas de deuxième degré. Il n'a pas voulu s'en donner les moyens.
Illustrations :
|
Senza titolo de Giulio Paolini (1963)
|
Igloo de Mario Merz
|
Bernar Venet : moi est ailleurs
À propos de l'exposition Peintures génératives sur rdv à la galerie Perrotin
Qu'est-ce qu'un algorithme ? Saisissant le prétexte de rendre compte des peintures génératives de Bernar Vernet, Catherine Millet d'Art Press se pose cette question et y apporte une réponse simple car dénuée de tout snobisme de geek. C'est une recette de cuisine ! Un descriptif des opérations par lesquelles des ingrédients de départ vont permettre d'atteindre le résultat désiré. C'est un protocole. À l'image que ceux que Bernar Venet fait élaborer par des informaticiens pour créer des œuvres plastiques reconstituant en version numérique des effondrements évoquant ceux de grandes pièces métalliques qu'il est connu pour avoir spectaculairement orchestrés. La possibilité de créer des œuvres par sa seule parole ainsi que le permet aujourd'hui l'IA ne pouvait que séduire cet artiste aimant s'abstraire de ses créations,. Il brille notamment par son absence à ses propres vernissages qu'il programme sans avoir vu la moindre pièce parmi celles qui y seront présentées. Sa façon de s'opposer à l'expression subjective et au lyrisme que l'on confond souvent avec l'art ne réside pas dans la promotion de l'ordre et de la rationalité. Venet appartient à l'école du chaos. L'ordre objectif n'est là que pour être ruiné méthodiquement selon un protocole déterminé, un algorithme. On comprend mieux qu'à ses débuts new-yorkais, l'homme ait choisi d'exposer des photographies agrandies d'ouvrages de mathématique, d'astrophysique, de grammaires ou de cours de la bourse voire de prévisions météo. L'important étant de nier toute subjectivité et toute possibilité d'interprétation par le spectateur en l'absence de toute expression personnelle de l'artiste. « Je suis une machine » disait Warhol.
Illustrations : Bernar Venet et son Effondrement : 200 tonnes, Le Muy, 2015 Photo Jérôme Cavaliere, Marseille. © Adagp, Paris, 2020

 Article écrit par Eric Sembach
Article écrit par Eric Sembach